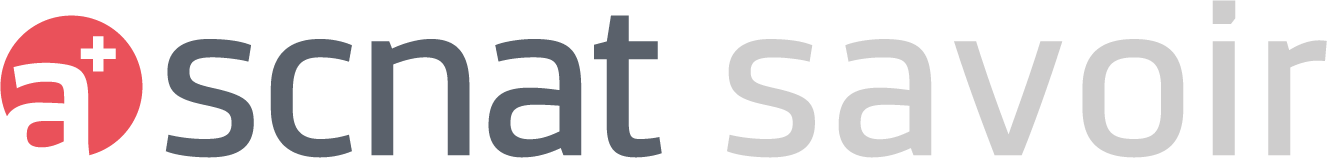Qualité des eaux

In den letzten Jahrzehnten ist die Wasserqualität dank wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischem Handeln in der Schweiz gestiegen. Allerdings ist es verfrüht, sich auf den Lorbeeren auszuruhen: Mikroverunreinigungen nehmen zu, die biologische Vielfalt hat abgenommen und die Klimaänderung zeigt bereits ihre Auswirkungen auf die Gewässer. Zudem machen wir den Gewässern auch immer mehr den Platz streitig; mehr dazu auf der Seite Ökomorphologie.
Physikalische Wasserqualität
Für die Einordnung der Wasserqualität wird zwischen physikalischer und chemischer Wasserqualität unterschieden. Unter der physikalischen Wasserqualität werden einige einfach messbare Eigenschaften verstanden, die einen grossen Einfluss auf die Umwelt, aber auch auf den Menschen haben.
Die Wassertemperatur ist nicht nur für das Überleben der Fische entscheidend. So sind beispielsweise die Kernkraftwerke auf Wasser zur Kühlung der Reaktoren angewiesen. Die Wasserhärte, also die Menge an gelösten Salzen, ist eine weitere wichtige Eigenschaft. Hartes Wasser belastet zum Beispiel Waschmaschinen und führt zum Verkalken von Geräten. Weitere Faktoren sind die Trübung und der pH-Wert.
Chemische Wasserqualität
Chemische Wasserqualität bezeichnet die im Wasser enthaltenen gelösten Stoffe. Wasser kommt natürlich nie rein vor, sondern enthält viele verschiedene gelöste Stoffe. Gelöste Salze (umgangssprachlich Mineralien) sind wichtig für den menschlichen Körper. Wasser kann aber auch Schwermetalle, Pestizide, Arzneimittel und weitere, für den Menschen und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten.
Die im Wasser gelösten Stoffe bilden ein Abbild des Einzugsgebietes dar. So enthält Wasser aus Gebieten mit leicht löslichen Kalksteinen mehr Salze als Wasser aus kristallinem Gestein (siehe auch Grundwasser) und Wasser aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen enthält mehr Pestizide und Düngemittel.
Neue Verunreinigungen
Seit einigen Jahren geraten auch neue Stoffe in den Fokus der Wissenschaft. Besonders besorgt ist man über die Zunahme von Mikroverunreinigungen aus Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln. Dazu gehören Hormone und Nanopartikel, über deren Verbleib und Umweltwirkung man noch wenig weiss. Insbesondere PFAS (Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen) erregen viel Aufsehen. Diese synthetischen Chemikalien sind in der Industrie allgegenwärtig. Ihre hohe Beständigkeit ist zum Beispiel für Anwendungen in Kleidungen, Antihaftbeschichtungen, Verpackungen, Feuerlöschern und vielen weiteren Bereichen spannend. Gelangen sie in die Umwelt, ist jedoch gerade diese Eigenschaft problematisch: PFAS können Jahrhunderte lang in der Umwelt verweilen und sich in der Natur oder im Menschen anreichern. Heute sind sie praktisch überall und in jedem Menschen nachweisbar.
Die Wassertemperatur steigt, die Abflüsse ändern sich
Auch die Klimaveränderung stellt eine neue und doppelte Herausforderung für die Ökologie der Gewässer dar: Die Abflüsse verändern sich und parallel zur Lufttemperatur stiegen die Wassertemperaturen. Bis ins Jahr 2085 rechnen die Fachleute mit einer Erhöhung der Lufttemperatur von drei bis vier Grad Celsius. Die Erwärmung wird sich insbesondere im Sommer bemerkbar machen. Die jahreszeitliche Umverteilung der Abflüsse wird zu geringeren sommerlichen Abflüssen im Mittelland, Jura und auf der Alpensüdseite führen. Die beiden Faktoren „wärmeres Wasser“ und „tiefere Wasserstände im Sommer“ führen dazu, dass sich das Wasser schneller erwärmt. Das wird Folgen für das Leben in den Gewässern und die Wassernutzung haben. Die bisherige Erwärmung führte bereits zu einem Rückzug der Forellen in Gebiete, die 100 bis 200 Höhenmeter höher als ursprünglich liegen (Hari et al. 2006). Verringerte und wärmere Abflüsse senken zudem die Sauerstoffkonzentration stark und begünstigen die Ausbreitung von Fischkrankheiten wie der proliferativen Nierenkrankheit PKD.
Referenzen und weiterführende Literatur
Januar 2026, Basil Stocker, auf Basis des Berichts Wasser in der Schweiz – ein Überblick